



Next: Galaxy surveys: description
Up: Observations spectroscopiques des
Previous: Observation des amas
S'il est assez facile maintenant d'avoir une mesure du
décalage vers le rouge d'un amas relativement proche en prenant les
spectres de quelques galaxies, la situation est très différente en ce qui
concerne sa dispersion de vitesse.
Les dispersions de vitesse ont une grande importance pour comprendre
l'évolution dynamique des amas et aussi un rôle plus général,
en tant que variable du plan fondamental.
Parallélement à l'analyse dynamique des amas se pose le problème
de l'évolution des galaxies en leur sein.
L'effet morphologie--densité montre
que les galaxies dans les régions centrales
des amas riches sont en majeure partie des elliptiques (Dressler, 1980).
En plus, dans les amas on trouve (grâce aux observations de la raie
à 21cm de l'hydrogène) des spirales qui contiennent peu de gaz
par rapport aux galaxies du même type morphologique se trouvant en dehors
des amas (spirales ``anémiques"). Le fait le plus surprenant
est que certains amas lointains (disons au delà de 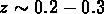 )
montrent une proportion significative de galaxies bleues
qui ne sont pas observées dans
les amas proches (Butcher & Oemler, 1978; 1984). Dressler & Gunn (1992)
ont trouvé que cette population de galaxies bleues est composée
de trois classes différentes: les AGN, les galaxies à raies d'émission
étroites, et les galaxies qu'ils ont appelées ``E+A", parce qu'elles
sont semblables aux elliptiques mais ont des raies d'absorption de Balmer
très fortes, qui peuvent être expliquées par la présence d'étoiles
de type A, ce qui impliquerait que nous observons ces galaxies
)
montrent une proportion significative de galaxies bleues
qui ne sont pas observées dans
les amas proches (Butcher & Oemler, 1978; 1984). Dressler & Gunn (1992)
ont trouvé que cette population de galaxies bleues est composée
de trois classes différentes: les AGN, les galaxies à raies d'émission
étroites, et les galaxies qu'ils ont appelées ``E+A", parce qu'elles
sont semblables aux elliptiques mais ont des raies d'absorption de Balmer
très fortes, qui peuvent être expliquées par la présence d'étoiles
de type A, ce qui impliquerait que nous observons ces galaxies
 ans après un sursaut ( burst) de formation d'étoiles.
On pense que ces galaxies riches en gaz sont arrivées récemment
dans le coeur de l'amas, où elles commencent une phase
d'intense formation stellaire. Les mécanismes plus probables qui ont
été suggerés sont la ram pressure du gaz intraamas, ou
les interactions entre galaxies.
ans après un sursaut ( burst) de formation d'étoiles.
On pense que ces galaxies riches en gaz sont arrivées récemment
dans le coeur de l'amas, où elles commencent une phase
d'intense formation stellaire. Les mécanismes plus probables qui ont
été suggerés sont la ram pressure du gaz intraamas, ou
les interactions entre galaxies.
On se demande pourquoi cet effet devient visible à  .
On se demande aussi s'il a été possible que les galaxies elliptiques
ou les galaxies S0 des régions centrales des amas se soient formées par
fusion ( merging)
de galaxies de types morphologiques plus avancés dans la séquence de
Hubble. La grande dispersion de vitesse existante dans les amas n'est pas
favorable
à la fusion, mais la question reste ouverte (voir par exemple Lavery et
al., 1992; Mamon, 1992).
En outre, quelle est la relation avec l'évolution des galaxies
``de champ", clairement montrée par les comptages de galaxies (Tyson, 1988)?
La tâche dans ce cas est très difficile, car une réponse à
toutes ces questions exige des échantillons d'amas à
différentes distances,
où chaque amas doit être étudié en détail.
.
On se demande aussi s'il a été possible que les galaxies elliptiques
ou les galaxies S0 des régions centrales des amas se soient formées par
fusion ( merging)
de galaxies de types morphologiques plus avancés dans la séquence de
Hubble. La grande dispersion de vitesse existante dans les amas n'est pas
favorable
à la fusion, mais la question reste ouverte (voir par exemple Lavery et
al., 1992; Mamon, 1992).
En outre, quelle est la relation avec l'évolution des galaxies
``de champ", clairement montrée par les comptages de galaxies (Tyson, 1988)?
La tâche dans ce cas est très difficile, car une réponse à
toutes ces questions exige des échantillons d'amas à
différentes distances,
où chaque amas doit être étudié en détail.
Dans ce cadre, puisqu'il est nécessaire de rechercher des candidats amas
sur des grandes régions du ciel, les plaques au foyer
primaire d'un télescope de classe 4m
offrent un outil très efficace pour détecter des amas
à des décalages vers le rouge assez élevés.
Par exemple, en fig. (extrait de Cappi et al., 1989),
on peut avoir une idée des décalages vers le rouge typiques
auxquels on peut espérer identifier des amas.
(extrait de Cappi et al., 1989),
on peut avoir une idée des décalages vers le rouge typiques
auxquels on peut espérer identifier des amas.

Figure: Visibilités des amas de galaxies en fonction du décalage
vers le rouge (Cappi et al. 1989)
Dans un travail en collaboration avec E.V.Held et B.Marano de l'Observatoire
de Bologne (voir annexe en appendice), qui a pour but d'étudier un
échantillon d'amas à moyenne ou grande distance,
j'ai observé 5 amas au télescope de 3.6m de l'ESO à La Silla,
avec EFOSC en mode image et en mode spectroscopie multi-objet (MOS).
Il s'agit des amas ACO A3639, A3663, A3889, de l'amas pauvre ACO
S0102, et d'un des nos candidats, N1261.
La première nuit permet de prendre les images des champs, et grâce
à un logiciel opportun on peut ensuite sélectionner les objets
dont on veut prendre les spectres.
Le mode MOS fonctionne grâce à la machine PUMA,
réalisée par le groupe de Toulouse (Dupin et al., 1987;
Soucail et al., 1987)
qui permet de préparer des masques avec des trous ou des fentes
(ces dernières réalisées avec une séquence de trous)
centrés sur les objets qu'on veut observer.
La plaque est placée au foyer Cassegrain,
et EFOSC est relié au spectrographe Boller & Chivens.
Nous avons obtenu en tout 64 décalages vers le rouge,
et nous avons
en plus l'imagerie en quatre bandes (B, V, R, i) pour chaque amas.
Nous avons dépouillé les données avec MIDAS (j'ai
réalisé une série de petites routines qui permettent une
extraction et une calibration quasi-automatique des spectres).
Une fois calibré le spectre en longueur d'onde, j'ai
calculé les décalages vers le rouge dans un premier temps avec un ajustement
gaussien des raies, ensuite avec deux programmes de corrélation croisée
(Tonry & Davis, 1979)
du logiciel IRAF ( fxcor et xcsao). Les résultats sont
comparables. Les erreurs typiques sont de l'ordre de  km/s.
Les valeurs moyennes, les dispersions des vitesses
(là où les données étaient suffisantes) et les erreurs
résultantes ont été calculées en
appliquant la méthode de Danese et al. (1980)
décrite ci-dessus. Dans le cas de A3889 et S0102,
à partir des vitesses et des positions des
galaxies on a aussi estimé la masse de l'amas.
km/s.
Les valeurs moyennes, les dispersions des vitesses
(là où les données étaient suffisantes) et les erreurs
résultantes ont été calculées en
appliquant la méthode de Danese et al. (1980)
décrite ci-dessus. Dans le cas de A3889 et S0102,
à partir des vitesses et des positions des
galaxies on a aussi estimé la masse de l'amas.
La méthode la plus fréquente pour estimer la masse d'un amas est
sans doute l'application du théorème du viriel. Dans l'hypothèse
d'isotropie des orbites des galaxies et de symétrie sphérique,
la masse d'un amas est donnée par (Malumuth & Kriss, 1986; voir
aussi Bahcall & Tremaine, 1981):
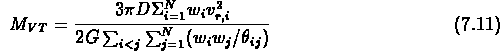
où D est la distance de l'amas,  la vitesse radiale
de la galaxie relativement au centre de l'amas,
la vitesse radiale
de la galaxie relativement au centre de l'amas,  est la distance angulaire entre les galaxies i et j.
est la distance angulaire entre les galaxies i et j.
Le mieux étudié parmi ces candidats est l'amas ACO
A3889 , de richesse 2 et classe de distance 6, pour lequel nous disposons
de 24 décalages vers le rouge (plus deux galaxies superposées à  ).
En fig.
).
En fig. je montre le spectre de la galaxie la plus
lumineuse de l'amas.
je montre le spectre de la galaxie la plus
lumineuse de l'amas.

Figure: Spectre de la galaxie la plus brillante de l'amas A3889
Nous avons trouvé pour cet amas un redshift
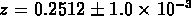 , et calculé une dispersion de vitesse
radiale
, et calculé une dispersion de vitesse
radiale  km/s (-150, +248) et une
dispersion de vitesse totale
km/s (-150, +248) et une
dispersion de vitesse totale  km/s (-328, +475).
km/s (-328, +475).
Nous avons utilisé la méthode décrite ci-dessus pour estimer
sa masse: on trouve 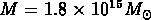 , qui est
une valeur courante pour un amas de cette taille.
, qui est
une valeur courante pour un amas de cette taille.
Le deuxième amas que nous avons étudié est un peu plus proche
et moins riche, appartenant au catalogue ACO des
amas pauvres (c'est à dire, ceux qui ne satisfont pas les critères
d'Abell ): il s'agit de S0102, pour lequel nous avons mesuré
21 décalages vers le rouge, et nous avons trouvé un décalage vers
le rouge moyen
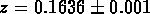 , une dispersion de vitesse radiale
, une dispersion de vitesse radiale
 km/s (-145, +234) et une dispersion de vitesse
totale
km/s (-145, +234) et une dispersion de vitesse
totale  km/s (-316, +450).
J'ai estimé sa masse avec le théorème du viriel:
km/s (-316, +450).
J'ai estimé sa masse avec le théorème du viriel:
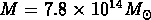 .
.
Nous avons pu mesurer le redshift d'un candidat à grande distance,
N1261C1 (nous l'avons appelé ainsi parce qu'il a été identifié
sur une plaque qui couvre en partie l'amas globulaire NGC1261).
Cet amas possède
un couple de galaxies centrales, son aspect est très
régulier, et il se trouve à  .
Son spectre, obtenu après deux heures et demie d'integration
(trois expositions de durée respective 1h + 1h + 30mn)
est montré en fig.
.
Son spectre, obtenu après deux heures et demie d'integration
(trois expositions de durée respective 1h + 1h + 30mn)
est montré en fig.

Figure: Spectre d'une des deux galaxies centrales de l'amas N1261C1
Les principales données relatives aux amas observés
sont présentés dans la table  .
Les résultats généraux de l'étude spectroscopique sont présentées
dans la table
.
Les résultats généraux de l'étude spectroscopique sont présentées
dans la table  .
.
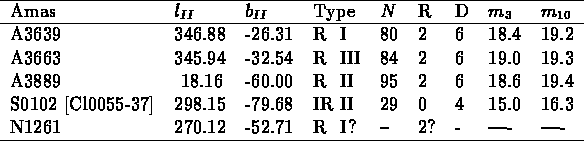
Table: Données relatives aux amas observés:
nom,  et
et  , type (Regulier ou IRregulier & classification de
Bautz-Morgan),
, type (Regulier ou IRregulier & classification de
Bautz-Morgan),  , richesse, classe de distance,
magnitude J de la troisième et de la dixième galaxie
, richesse, classe de distance,
magnitude J de la troisième et de la dixième galaxie
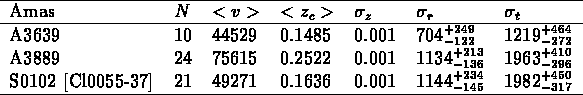
Table: Résultats
La mesure des dispersions de vitesse des amas est indispensable,
pour estimer la masse de l'amas, qui avec
la photométrie nous donne le rapport  , et qui nous permet
d'avoir une information sur
, et qui nous permet
d'avoir une information sur  à l'échelle des amas.
En plus, les propriétés de la distribution des dispersions de vitesse
peuvent constituer un test des théories de formation de galaxies
(Evrard, 1989; Peebles, Daly, Juszkiewicz (1989); Frenk et al., 1990).
à l'échelle des amas.
En plus, les propriétés de la distribution des dispersions de vitesse
peuvent constituer un test des théories de formation de galaxies
(Evrard, 1989; Peebles, Daly, Juszkiewicz (1989); Frenk et al., 1990).
Il a été suggeré ces dernières anneés
années que les amas lointains pourraient
présenter une dispersion de vitesse supérieure à celle des amas proches.
Par exemple, Zabludoff et al. (1990) constatent que la dispersion de vitesse
médiane d'un échantillon de 12 amas à très grand décalage vers
le rouge ( ) disponible dans la littérature (les dispersions
de 7 de ces amas ont été publiées par Gunn, 1989)
est nettement supérieure à la valeur correspondante pour
leur échantillon d'amas proches (
) disponible dans la littérature (les dispersions
de 7 de ces amas ont été publiées par Gunn, 1989)
est nettement supérieure à la valeur correspondante pour
leur échantillon d'amas proches ( ): 1470 km/s contre 744 km/s.
Leur histogramme des dispersions de vitesse est montré en fig.
): 1470 km/s contre 744 km/s.
Leur histogramme des dispersions de vitesse est montré en fig.
 .
.

Figure: Histogramme des dispersions de vitesse d'un échantillon d'amas
de  (Zabludoff et al., 1990)
(Zabludoff et al., 1990)
Le problème est que les amas les mieux observables à grande distance
sont les plus riches et les plus réguliers, et puisqu'il existe une relation
(très dispersée) entre richesse et dispersion de vitesse, il
est logique de suspecter un effet de sélection.
Par exemple, les amas que nous avons observés ont des dispersions de
vitesse qui ne sont pas exceptionnelles, mais sûrement supérieures à
la moyenne des amas proches; cela ne doit pas nous surprendre, car
nous avons voulu sélectionner les amas les plus riches!
En outre, les effets de projection deviennent critiques quand on observe
à des décalages vers le rouge très élevés.
Je crois que
les dernières données publiées par Dressler et Gunn (1992) confirment
cette explication: ils ont mesuré les décalages vers le rouge
d'un plus grand nombre de galaxies
dans les 7 amas étudiés par Gunn (1989):
les nouvelles dispersions sont généralement inférieures;
avec les nouvelles données (voir fig. )
on trouve une dispersion de
vitesse médiane de
)
on trouve une dispersion de
vitesse médiane de  km/s pour les amas lointains ,
qui est cette fois 60% plus grande que
la valeur pour les amas proches, ce qui est plus facilement
explicable par un effet de sélection.
km/s pour les amas lointains ,
qui est cette fois 60% plus grande que
la valeur pour les amas proches, ce qui est plus facilement
explicable par un effet de sélection.

Figure: Dispersion de vitesse des amas en fonction du redshift.
Triangles: Zabludoff et al.; carrés: nos amas; hexagones: Dressler & Gunn




Next: Galaxy surveys: description
Up: Observations spectroscopiques des
Previous: Observation des amas
alberto cappi
Wed Feb 5 10:43:08 MET 1997
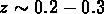 )
montrent une proportion significative de galaxies bleues
qui ne sont pas observées dans
les amas proches (Butcher & Oemler, 1978; 1984). Dressler & Gunn (1992)
ont trouvé que cette population de galaxies bleues est composée
de trois classes différentes: les AGN, les galaxies à raies d'émission
étroites, et les galaxies qu'ils ont appelées ``E+A", parce qu'elles
sont semblables aux elliptiques mais ont des raies d'absorption de Balmer
très fortes, qui peuvent être expliquées par la présence d'étoiles
de type A, ce qui impliquerait que nous observons ces galaxies
)
montrent une proportion significative de galaxies bleues
qui ne sont pas observées dans
les amas proches (Butcher & Oemler, 1978; 1984). Dressler & Gunn (1992)
ont trouvé que cette population de galaxies bleues est composée
de trois classes différentes: les AGN, les galaxies à raies d'émission
étroites, et les galaxies qu'ils ont appelées ``E+A", parce qu'elles
sont semblables aux elliptiques mais ont des raies d'absorption de Balmer
très fortes, qui peuvent être expliquées par la présence d'étoiles
de type A, ce qui impliquerait que nous observons ces galaxies
 ans après un sursaut ( burst) de formation d'étoiles.
On pense que ces galaxies riches en gaz sont arrivées récemment
dans le coeur de l'amas, où elles commencent une phase
d'intense formation stellaire. Les mécanismes plus probables qui ont
été suggerés sont la ram pressure du gaz intraamas, ou
les interactions entre galaxies.
ans après un sursaut ( burst) de formation d'étoiles.
On pense que ces galaxies riches en gaz sont arrivées récemment
dans le coeur de l'amas, où elles commencent une phase
d'intense formation stellaire. Les mécanismes plus probables qui ont
été suggerés sont la ram pressure du gaz intraamas, ou
les interactions entre galaxies.
 .
On se demande aussi s'il a été possible que les galaxies elliptiques
ou les galaxies S0 des régions centrales des amas se soient formées par
fusion ( merging)
de galaxies de types morphologiques plus avancés dans la séquence de
Hubble. La grande dispersion de vitesse existante dans les amas n'est pas
favorable
à la fusion, mais la question reste ouverte (voir par exemple Lavery et
al., 1992; Mamon, 1992).
En outre, quelle est la relation avec l'évolution des galaxies
``de champ", clairement montrée par les comptages de galaxies (Tyson, 1988)?
La tâche dans ce cas est très difficile, car une réponse à
toutes ces questions exige des échantillons d'amas à
différentes distances,
où chaque amas doit être étudié en détail.
.
On se demande aussi s'il a été possible que les galaxies elliptiques
ou les galaxies S0 des régions centrales des amas se soient formées par
fusion ( merging)
de galaxies de types morphologiques plus avancés dans la séquence de
Hubble. La grande dispersion de vitesse existante dans les amas n'est pas
favorable
à la fusion, mais la question reste ouverte (voir par exemple Lavery et
al., 1992; Mamon, 1992).
En outre, quelle est la relation avec l'évolution des galaxies
``de champ", clairement montrée par les comptages de galaxies (Tyson, 1988)?
La tâche dans ce cas est très difficile, car une réponse à
toutes ces questions exige des échantillons d'amas à
différentes distances,
où chaque amas doit être étudié en détail.

 km/s.
Les valeurs moyennes, les dispersions des vitesses
(là où les données étaient suffisantes) et les erreurs
résultantes ont été calculées en
appliquant la méthode de Danese et al. (1980)
décrite ci-dessus. Dans le cas de A3889
km/s.
Les valeurs moyennes, les dispersions des vitesses
(là où les données étaient suffisantes) et les erreurs
résultantes ont été calculées en
appliquant la méthode de Danese et al. (1980)
décrite ci-dessus. Dans le cas de A3889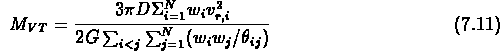
 la vitesse radiale
de la galaxie relativement au centre de l'amas,
la vitesse radiale
de la galaxie relativement au centre de l'amas,  est la distance angulaire entre les galaxies i et j.
est la distance angulaire entre les galaxies i et j.
 ).
En fig.
).
En fig.
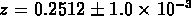 , et calculé une dispersion de vitesse
radiale
, et calculé une dispersion de vitesse
radiale  km/s (-150, +248) et une
dispersion de vitesse totale
km/s (-150, +248) et une
dispersion de vitesse totale  km/s (-328, +475).
km/s (-328, +475).
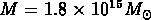 , qui est
une valeur courante pour un amas de cette taille.
, qui est
une valeur courante pour un amas de cette taille.
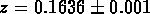 , une dispersion de vitesse radiale
, une dispersion de vitesse radiale
 km/s (-145, +234) et une dispersion de vitesse
totale
km/s (-145, +234) et une dispersion de vitesse
totale  km/s (-316, +450).
J'ai estimé sa masse avec le théorème du viriel:
km/s (-316, +450).
J'ai estimé sa masse avec le théorème du viriel:
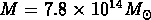 .
.
 .
Son spectre, obtenu après deux heures et demie d'integration
(trois expositions de durée respective 1h + 1h + 30mn)
est montré en fig.
.
Son spectre, obtenu après deux heures et demie d'integration
(trois expositions de durée respective 1h + 1h + 30mn)
est montré en fig.
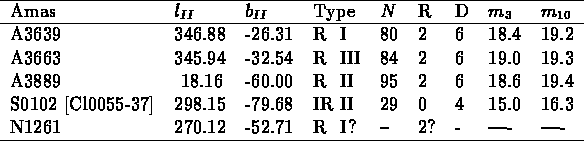
 et
et  , type (Regulier ou IRregulier & classification de
Bautz-Morgan),
, type (Regulier ou IRregulier & classification de
Bautz-Morgan),  , richesse, classe de distance,
magnitude J de la troisième et de la dixième galaxie
, richesse, classe de distance,
magnitude J de la troisième et de la dixième galaxie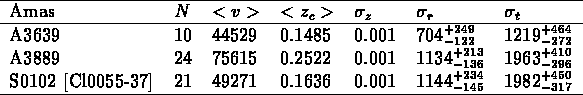
 , et qui nous permet
d'avoir une information sur
, et qui nous permet
d'avoir une information sur  à l'échelle des amas.
En plus, les propriétés de la distribution des dispersions de vitesse
peuvent constituer un test des théories de formation de galaxies
(Evrard, 1989; Peebles, Daly, Juszkiewicz (1989); Frenk et al., 1990).
à l'échelle des amas.
En plus, les propriétés de la distribution des dispersions de vitesse
peuvent constituer un test des théories de formation de galaxies
(Evrard, 1989; Peebles, Daly, Juszkiewicz (1989); Frenk et al., 1990).
 ) disponible dans la littérature (les dispersions
de 7 de ces amas ont été publiées par Gunn, 1989)
est nettement supérieure à la valeur correspondante pour
leur échantillon d'amas proches (
) disponible dans la littérature (les dispersions
de 7 de ces amas ont été publiées par Gunn, 1989)
est nettement supérieure à la valeur correspondante pour
leur échantillon d'amas proches ( ): 1470 km/s contre 744 km/s.
Leur histogramme des dispersions de vitesse est montré en fig.
): 1470 km/s contre 744 km/s.
Leur histogramme des dispersions de vitesse est montré en fig.

 (Zabludoff et al., 1990)
(Zabludoff et al., 1990) km/s pour les amas lointains
km/s pour les amas lointains